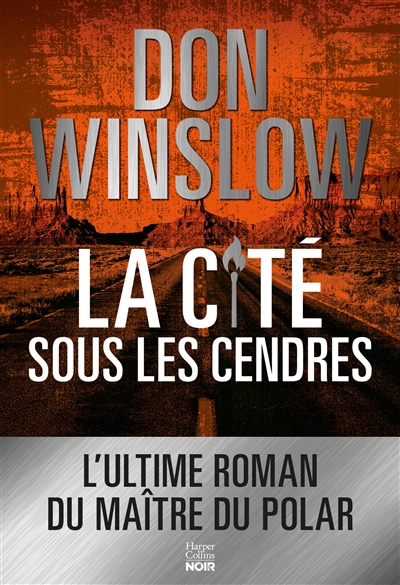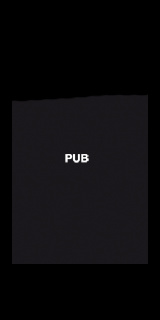Contenu
Pascal Garnier, si loin...

© Isabelle Roche
06 mars 2010 -
Je ne l'aurai rencontré qu'en trois occasions en un peu moins d'un an ; une première fois en février 2009 pour une interview, puis ensuite à son initiative, juste "comme ça", pour bavarder un peu. Je me souviens de ce matin où, un peu méfiante parce qu'échaudée par de trop nombreux appels publicitaires, j'avais décroché mon téléphone après plusieurs sonneries et laissé tomber un "allô ?" à peine audible, plein de suspicion, auquel avait répondu une voix que j'avais aussitôt reconnue : "Bonjour, Pascal Garnier à l'appareil. Je dois venir à Paris la semaine prochaine pour quelques rendez-vous. J'aurai sans doute deux ou trois trous... Vous auriez le temps de venir prendre un café ?". Et nous nous retrouvâmes en effet autour d'un café à La Coupole, par une fin d’après-midi grisonnante et fraîche. Un peu plus tard, en décembre, je recevais un nouveau coup de fil – "Bonjour, Pascal Garnier à l'appareil…" – et nous nous fixâmes rendez-vous pour déjeuner. Nous partageâmes donc un plateau de sushis arrosé de thé vert à proximité de son hôtel. C'était le jour de mon anniversaire. J'avais trouvé belle la coïncidence.
En trois rencontres, Pascal Garnier était devenu, pour moi, beaucoup plus qu'un écrivain-sympathique-dont-j'apprécie-les-livres. Pas encore un ami – je crois que l'amitié se développe sur le long terme et se scelle vraiment à travers des échanges et des partages tels que nous n’aurons pas eu le temps d'en connaître. Mais une personne avec qui s'était nouée une complicité étroite – éphémère et profonde à la fois, qui gagnait en profondeur d'une rencontre l'autre et aurait probablement vite évolué en franche camaraderie avant de virer à l'amitié.
L'interview, déjà, s'était déroulée dans une ambiance cordiale et chaleureuse. Une sympathique décontraction s'était installée dès les premiers mots échangés. Tout chez lui incitait à la spontanéité et mettait à l'aise l'interlocuteur. Sa conversation était comme son écriture : simple, directe et pudique à la fois, ponctuée à tout moment de ces images sublimes qui font merveille dans ses romans. Mais s'il m'est arrivé souvent de rire en lisant la plupart d’entre eux je ne me souviens pas d'avoir eu envie de rire en sa présence. Sa voix presque en retrait, sa silhouette menue – là derrière la table ou debout dans la rue enveloppée de son manteau noir – son regard qui parfois glissait hors champ, par exemple pour murmurer que "Revenir à Paris, c'est un peu comme retrouver une vieille maîtresse…" : à tous ces petits signes je devinais l'ombre de ce désarroi qui rampe sous l'humour dont il pare ses textes.
Quand nous nous sommes revus ensuite la décontraction était toujours de mise, au point que le tutoiement a souvent affleuré. Sans toutefois parvenir à s'imposer : un "tu" pour dix "vous"… comme si nous ne savions sur quel pronom danser. Il n'y avait plus à nos conversations aucune motivation professionnelle et nos échanges ont alors pris, çà et là, un tour plus personnel. Je crois que notre dernière rencontre a été marquée par une confiance réciproque d'une rare qualité. Lui m'a parlé de ses ennuis de santé, de ses peurs, très ouvertement mais avec une infinie pudeur puis m'a expliqué combien cela avait changé sa façon de voir la vie, et comment l'écriture de son prochain roman allait en être transformée – "Il sera très différent des autres ; il n'y aura pas d'histoire…" Moi je lui ai raconté pourquoi j'avais un joueur de flûte un peu elfique tatoué dans le dos, juché sur un crâne défoncé et tout entouré d’esprits flottants ; je me suis même surprise à formuler des choses restées jusqu'alors très obscures à propos de mon rapport au corps et au merveilleux.
À quoi il a souri et m'a dit, avec un regard en coin, "Vous êtes quand même une drôle de bonne femme !"
Je me souviens d'avoir été toute remuée quand, en nous quittant, nous nous sommes fait la bise – avec ce geste tout naturel de nous tenir brièvement par les épaules. J'avais senti sous l'étoffe des vêtements combien le corps était frêle ; songeant à la voix, si peu sonore, j'avais pensé à la fragilité d’une flamme de bougie vacillant au vent. Et le temps de cette brève étreinte ce fut comme si j'étais traversée par ses blessures intérieures. Une fulgurance soudaine qui a fait craquer des sarments au fond de moi comme sous l’assaut du feu ; une fulgurance beaucoup plus intense que celle fusant à la lecture de ses livres car il n'y avait plus là son art d'écrire pour habiller et atténuer ces fêlures. C'était une émotion poignante qui m'avait bouleversée, et dont j'avais voulu m'ébrouer parce que l'intensité en était presque insupportable.
En découvrant ses toiles et ses dessins voici à peine un mois c'est tout ce désarroi, tout ce désespoir que j'avais senti refluer. À nouveau j'entendais craquer les sarments… presque aussi fort qu'en lisant son dernier roman, Le Grand loin, qui m’a paru si proche en noirceur de L'A 26 et dans lequel il m'a semblé déceler, tout au long du texte, comme une défaite, un renoncement, quelque chose d'abattu et de vaincu qui me renvoyait au visage lamentable de Yolande fin folle dans les dernières lignes de L'A 26. Mais ai-je de mon souvenir de lecture une perception juste ou bien est-ce la nouvelle de sa mort qui le colore de la sorte ?
C'est toujours douloureux, et difficile, de se dire que les morts ne sont plus là, même très loin de soi. Penser à eux ne suffit pas. Ni se plonger dans leurs œuvres quand ils sont artistes. Alors on leur parle, ou on leur écrit – comme Serge Safran et Marcus Malte l'ont fait pour Pascal Garnier. Et moi je n’arrive pas à me convaincre que je ne vivrai plus jamais ce moment magique - l'entendre, en décrochant mon téléphone, m'annoncer sa venue prochaine à Paris et me proposer de le rejoindre pour boire un café. Le souvenir de sa voix dans le combiné est là si présent… Curieux entre-deux – savoir que c'est juste un souvenir et en même temps le sentir si prégnant qu'il est aussi concret que l'instant présentement vécu…
Je crois que je me les rappellerai longtemps, ces mots-là – "Bonjour, Pascal Garnier à l'appareil. Je dois venir à Paris la semaine prochaine pour quelques rendez-vous. J'aurai sans doute deux ou trois trous... Vous auriez le temps de venir prendre un café ?"
Je les guettais pour bientôt, à l'occasion de la sortie, au mois de mai, des Insulaires et autres romans (noirs)*. Mais je dois me rendre à l'évidence – ils resteront au seuil de ma mémoire, dans ce curieux entre-deux où gisent les souvenirs si denses qu'ils ont presque corps et font obstruction à l'oubli.
* Pascal Garnier, Les Insulaires et autres romans (noirs) (La Place du mort, Les Insulaires et Trop près du bord), à paraître le 6 mai 2010, éditions Zulma, 500 p. – 22,50 €.
Liens : Pascal Garnier | L'A26 | La Théorie du panda | Les Hauts du bas | M'sieur Victor | Lune captive dans un œil mort
Par Isabelle Roche