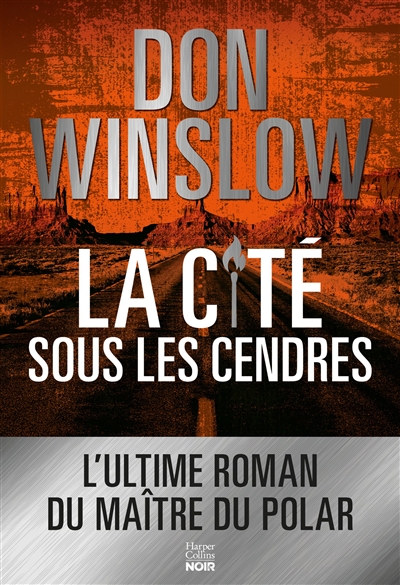Contenu
John Barleycorn : le cabaret de la dernière chance
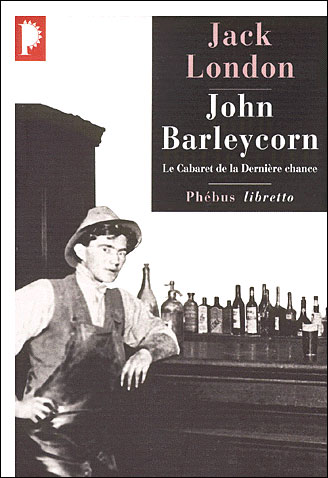


Poche
Réédition
Tout public
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Louis Postif, revu et complété par Noël Mauberret
Paris : Phébus, janvier 2000
250 p. ; 19 x 13 cm
ISBN 978-2-85940-606-9
Coll. "Libretto", 38
Jack London et John Barleycorn
Quand à quinze ans Jack London est en passe de se voir consacré "Prince des pilleurs d'huîtres" de l'estuaire d'Oakland, il donnerait une nuit de beuverie pour un sucre d'orge et ne sait pas remettre la tournée lorsqu'on lui offre un verre.
C'est pour lui une violence autrement redoutable de dilapider son argent avec les gueules cassées du Cabaret de la dernière chance, le repaire de ses nouveaux amis pilleurs, que de surmonter son aversion colossale pour l'alcool, si précoce : à cinq, puis à sept ans, il s'est intoxiqué à la bière et au vin âpre dans des proportions qu'un organisme un peu moins vigoureux n'aurait pas acceptées. Il en réchappe avec un dégoût et une défiance vis-à-vis de l'alcool dont vingt-cinq années d'excès en tous genres ne suffiront pas à le défaire totalement. Il mettra pourtant du cur à s'intoxiquer, de toutes les façons qui lui furent données de s'inoculer l'idée du suicide dans les veines. John Barleycorn Jean Grain-d'Orge, ainsi se plaît-on, outre-Atlantique, à désigner l'alcool, ses "chimériques certitudes" et sa générosité à toute épreuve - attend déjà son heure. La longue incubation de son désir de mort, faite d'aventure et de perdition, n'attend plus qu'un geste de London, décisif.
Mais London connaît l'usine beaucoup trop jeune pour réclamer de John Barleycorn une épaule compatissante ou le répit du guerrier sans guerre. Il lui demandera tout et tout de suite :
"Toute incursion sur les parcs à huîtres était un délit puni par la prison, la livrée infamante ou les fers. Qu'est-ce que cela pouvait me faire ? Les bagnards fournissaient des journées moins longues que les miennes à l'usine. Et j'entrevoyais une existence cent fois plus fabuleuse comme pilleur d'huîtres ou même comme forçat que comme perpétuel esclave de la machine." (p. 60)
Ce soir-là, au Cabaret de la dernière chance, il y a Nelson, Whisky Bob, Nicky le Grec, le Gros Georges, Frank le Français, Hans, Scotty et l'Araignée, "de rudes gaillards ne craignant ni Dieu ni diable, des rats de quai au corps agile. Certains repris de justice, et tous, ennemis de la loi, méritant la prison." Ils ont choisi leur camp (ou la Camarde les a choisis), et John Barleycorn en est, comme il sera de toutes les parties que jouera London, sur mer comme sur terre, avec les hobos alki-stiffs, trimardeurs en trains de marchandises qui s'envoient de l'alcool pur de pharmacien, ou au large du Japon, à la pêche aux phoques, au massacre, avec des Norvégiens sensibles et courageux comme des femmes :
"Notre bateau demeura deux semaines au port de Yokohama, et, pendant tout ce temps, nous ne connûmes guère du pays que ces bouges à matelots[...] Au beau milieu d'une nuit sombre, je regagnai notre goélette à la nage et m'endormis à poings fermés tandis que la police maritime fouillait le port à la recherche de mon cadavre, et exposait mes habits pour qu'on pût établir mon identité. (p. 126)
Mais c'est avec les pilleurs d'huîtres de l'estuaire d'Oakland que l'impulsion décisive est donnée. Nous sommes de retour à la dernière chance et le jeune Jack London, aux milieu de ses redoutables amis, a honte de l'avarice de sa misère, des sentiments mesquins qu'a développé en lui la débrouille, les embrouilles de la pauvreté et une intelligence dévouée entièrement à la survie. Il n'a encore rigoureusement rien partagé, dilapidé, et ne connaît rien de l'ivresse de l'indifférence, et il sacrifie sans hésiter son dégoût pour l'alcool (et quelques sucres d'orge...), pour partager corps et âme avec les pilleurs la seule réelle liberté qui leur soit accordée sur terre : celle "d'avancer le jour de leur mort", de braver les éléments, défier leurs lois et décider de leur existence.
"Si d'un jour à l'autre je devins véritablement un fort buveur, ce fut l'effet non pas d'un penchant pour l'alcool, mais d'une conviction intellectuelle." (p. 69)
John Barleycorn n'en demandait pas tant.
Vingt ans plus tard, Jack London s'est fait sa place au soleil de la célébrité, établi dans son ranch de la vallée de la lune avec une femme qui l'aime et qu'il aime, il a déjoué la Camarde de mille et une manières, il est aimé autant qu'admiré comme écrivain, mais il ne peut plus aligner ses mille mots quotidiens ni goûter les choses sans l'impulsion d'un cocktail carabiné préparé de main de maître par John Barleycorn en personne.
Parfaitement rompu à l'art de boire comme à celui du roman, il décide brutalement, en 1912, de déloger, comme chaque jour, "les chiens endormis dans les coins de sa cervelle", mais de les lâcher cette fois à tout rompre sur le double pessimiste dont l'alcool l'affuble et qui déprécie tout ce qui lui est cher, femme, amis, santé, écriture, dans des accès de lucidité terribles, d'intuition aveuglante, et parfois durables, que London désignera comme sa "Longue Maladie". (C'est plus joli que "Dépression mentale", mais ça y ressemble...)
Le romancier entreprend littéralement de doubler ce double impitoyable, d'en faire un personnage, John Barleycorn, et de traquer son action, son influence ou au contraire son apparente défection dans toutes les étapes décisives de son existence. Et il commence, comme il se doit, par décrire son personnage :
"À l'être imaginatif, John Barleycorn envoie les impitoyables syllogismes spectraux de la pure raison. Il examine la vie et toutes ses futilités avec l'il d'un philosophe allemand pessimiste. Il transperce toutes les illusions, transmuant toutes les valeurs. La Providence est le mal, la vérité un trompe-l'il, la vie une farce. Des hauteurs de sa calme démence, il considère avec la certitude d'un dieu que toute l'existence est affliction." (p. 28)
Et si London réalise avec Barleycorn le récit de sa déchéance, il prend une véritable délectation à suivre John Barleycorn à la trace et voir comment, très précisément, le gaillard s'y est pris pour installer la maladie en lui.
Évidemment, fin XIXe, outre-Atlantique aussi, l'alcool est l'opium et les opprimés, les antisociaux tombent au combat de la vie avant d'y goûter. La liberté sent le carnage. Et c'est par bien des côtés un tableau de désolation, de perdition encore, que London dresse en retraçant ses aventures. Mais finalement, d'une joute métaphysique avec John Barleycorn, en forme de récit autobiographique, il fait un roman d'aventure, mais d'aventure vraie, sordide et magnifique en même temps, avec de vraies illuminations, quotidiennes, des victoires cuisantes sur la déchéance qu'elles précipitent. L'enfer sans saison d'un écrivain qui avec ses mains, sa sauvagerie et son imagination, a échappé à la bestialité du matérialisme, au respectable destin de bête de somme.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces chronique dans le dossier Retour aux sources.
Citation
Et dans ma tanière de livres, mausolée de la pensée humaine, je bois, et je bois encore ; je déloge les chiens endormis dans les coins de ma cervelle ; je les invite à franchir les murs des préjugés et des lois pour galoper à travers les astucieux labyrinthes des croyances et des superstitions.
 |
|