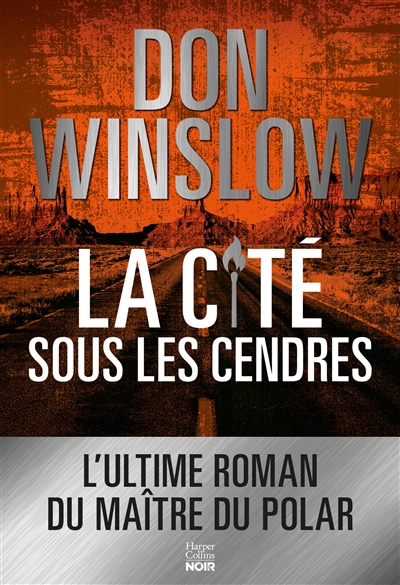Contenu
Cry Father : "Le pire scénario de Sam Peckinpah d'après Benjamin Whitmer

© k-libre/David Delaporte
k-libre : Benjamin Whitmer, j'ai lu Pike et Cry Father avec beaucoup d'intérêt et d'amusement, mais une question évidente se pose après cette double lecture. Quel est votre problème avec la notion de paternité ?
Benjamin Whitmer : C'est une bonne question ! Je venais tout juste d'être père quand j'ai commencé à écrire Cry Father, et la seule chose à laquelle je pensais était comment j'allais tout foutre en l'air. J'étais certain que j'allais être un mauvais père. J'ai grandi sans mon père, élevé uniquement par ma mère, qui travaillait très dur. Donc je ne savais pas ce que cela signifiait que d'avoir un père. Ce livre c'était seulement moi m'inquiétant : "Est-ce que je vais faire ça bien ?" "Est-ce que je ne vais pas traumatiser mon enfant ?" Je n'ai pas été moi-même un très bon fils. J'étais plutôt du genre fauteur de troubles. Ma mère a beaucoup souffert à cause de moi quand j'étais enfant. C'est ma façon de gérer mes peurs, ce n'est pas vraiment un problème, c'est une terreur !
k-libre : Du coup, c'est la raison pour laquelle tous vos personnages masculins semblent avoir des soucis avec leur femme et leurs enfants ?
Benjamin Whitmer : Oui, je suis très bon dans ce domaine ! Je suis un bon père. J'aime mes enfants. Je suis un père célibataire, et c'est ma façon de gérer ma peur. En l'écrivant, je ne ferai pas l'erreur de la reproduire.
k-libre : Vous avez beaucoup de style, un style désespéré et cynique. Pike était déjà un livre noir, mais Cry Father est une histoire pour le coup vraiment très noire. Comment vous définissez-vous en tant qu'auteur ?
Benjamin Whitmer : Je ne sais pas. Quand j'écrivais Pike, je ne me doutais pas qu'il s'agissait d'un roman noir, mais tout le monde me l'a dit. Quand j'ai commencé à écrire Cry Father, pour le coup je voulais écrire un roman noir, et aux États-Unis il a été publié comme de étant de la littérature générale. C'est étrange pour un pays qui a tendance à tout classer dans des cases. J'ai tendance à m'orienter vers la tragédie désormais. Dennis Lehane a un jour défini le roman noir comme le roman de la "tragédie de la classe ouvrière". C'est plus ou moins là où j'ai atterri. Je trouve ce genre intéressant et amusant, parfois il y a même de l'espoir.
k-libre : Justement, il y a de l'espoir dans Cry Father ?
Benjamin Whitmer : Je le pense. Je pense qu'il y en a un petit peu. Un peu d'espoir désespéré. C'est ma vision du monde, voyez-vous ? Il y a beaucoup de douleurs dans le monde.
k-libre : Les Américains dans ces tragédies de la classe ouvrière, parlent d'événements comme la guerre du Vietnam ou de Corée, du 11-Septembre ou de Katrina. Pourquoi vos romans font sans cesse référence à ce genre d'événements ?
Benjamin Whitmer : Dans le contexte de Cry Father c'est très important parce que ce sont des événements historiques qui ont créé un réseau de théories de la conspiration autour des personnages. Il y a un certain nombre de personnes aux États-Unis qui croient que le 11-Septembre a été orchestré par le gouvernement américain par exemple. Ce n'est bien sûr pas mon cas. Cela dit, je trouve intéressant qu'il y ait cette sorte d'aspiration : les gens se mettent à comblent les blancs eux-mêmes. Ils imaginent des histoires. Si je suis honnête avec moi-même, le 11-Septembre n'a eu aucun impact sur moi, quel qu'il soit. Je ne suis jamais allé à Manhattan. Je ne saurais pas reconnaître un banquier de Manhattan. Je crois que je l'ai raconté dans le roman, mais j'ai bien plus en commun avec un berger d'Afghanistan qu'avec un banquier de Manhattan. Mais pour nous c'était intéressant, car ça a créé un aspirateur à savoir. Les gens étaient là ce demandant ce qu'il s'était passé. Il y a tant de choses bizarres qui se produisent aux États-Unis sans que les gens ne savent pourquoi et surtout ne se posent de questions. Je ne sais pas pourquoi ou comment. On nous ment tellement, que c'est presque impossible de discerner la vérité dans tout ça. Avec la guerre en Irak, là on commence à se rendre compte qu'on nous a menti. La guerre du Vietnam, on nous a menti. La guerre du Golfe aussi, mais plus personne ne s'en souvient désormais. Pour moi l'idée de vivre à un endroit où l'on nous nourrit en permanence avec des conneries est très intéressante. Vous devez vous débrouillez seul pour démêler le vrai du faux. Vous ne pouvez pas vous reposer sur quelqu'un pour vous aider.
k-libre : Alors cela fait partie du contexte, de la fiction américaine ?
Benjamin Whitmer : Oui, c'est aussi lié à mon souci avec la paternité, cela me rappelle mon propre problème avec la paternité.
k-libre : C'est en effet évident dans vos romans. Dans Cry Father, il y a trois problèmes relatifs à la paternité. Que pouvez-vous nous dire à propos du personnage de Junior ?
Benjamin Whitmer : Pauvre Junior... Il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Je crois qu'il aime sa fille, il espère pouvoir être meilleur qu'il ne l'est, mais il n'en est juste pas capable. Dans le prolongement, je le comprends, j'aime mes enfants de tout mon cur, mais je sais que je les déçois constamment. C'est une des choses les plus importantes dans ma vie. C'est pour cela que j'écris dessus. J'écris sur ce que je comprends, et être un parent est une des choses auxquelles je pense en permanence. Dans dix ans, quand ils auront grandi, j'écrirai peut-être un livre différent.
k-libre : La réalité de Junior est différente de celle de son père...
Benjamin Whitmer : Son père ressemblait à Junior lorsqu'il était plus jeune, vous voyez, mais son père a réussi à trouver une issue. Il a arrêté de boire. Il est devenu quelqu'un de meilleur, ou en tout cas il a essayé. À vrai dire, je ne suis pas certain qu'il ait réellement réussi. D'ailleurs, je n'aime pas son père, je préfère Junior.
k-libre : Son père est désespéré. Avec ses failles il me fait penser à l'un des personnages de Fin de fiesta à Santa Barbara adapté au cinéma sous le titre Cutter's Way. Cutter est un rescapé de la guerre du Vietnam assez similaire à celui du père de Junior. Il a un souci avec l'une de ses jambes. Je crois que comme lui, le père de Junior a peur de mourir. Qu'il veut se suicider, mais qu'il préférait aussi que les autres le suicident.
Benjamin Whitmer : Junior est perdu comme jeune homme. Je ne sais pas comment vous avez grandi, mais Junior c'est ma façon d'écrire à propos des jeunes hommes que j'ai connu, qui ont grandi sans père, ou dont les pères ne valaient pas grand-chose. Vous devenez sauvage, et Junior est sauvage. Je ne suis pas sûr qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Il sait seulement que la manière dont il vit actuellement est invivable. Il n'en peut plus, il tombe en ruines. Il fait du mieux qu'il peut, mais il n'arrive pas à se relever, et il ne peut pas aller complètement de l'autre côté. J'ai rencontré tellement de jeunes gens comme ça. Ce livre est aussi dédié aux enfants de mon meilleur ami, tué par la police l'an dernier. C'est à toutes ces personnes que je pense. Celles qui s'approchent du bord. Certains s'apprêtent à mourir, ou à s'en sortir, mais ils ne peuvent pas faire les deux. Et Junior en est à ce point-là. À cet âge-là, il doit résoudre cette équation.
k-libre : Que pouvez-vous nous dire à propos de son problème oculaire ?
Benjamin Whitmer : J'adore le fait qu'il ait un mauvais il. Quand j'écrivais le livre, j'ai porté un cache-il pendant trois semaines. Il a un mauvais il, il peut voir avec je crois, mais cela rend les gens nerveux car c'est une sorte d'il larmoyant. Lors du premier jet du roman, il y avait un long passage expliquant l'histoire de cet il, mais je l'ai supprimé.
k-libre : Il y a aussi un thème lié à l'écologie dans votre Cry Father. Surtout en ce qui concerne l'eau non-potable...
Benjamin Whitmer : Il s'agit d'un vrai quartier à Denver. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je vivais à l'extérieur de Denver dans ce qui était une décharge : ordures, labos de méthamphétamine... Et les gens qui tentent de passer outre. Il y a quelque chose aux États-Unis à laquelle on pense tout le temps : soit il va falloir investir des milliards de dollars pour nettoyer ce quartier, soit le sacrifier. Il se trouve à moins de deux kilomètres de six autres décharges de ce type. Denver, comme toutes les autres villes, est en réalité un assemblage de deux ou trois villes : une est très pauvre, c'est là où vont les ordures, où il y a la pollution. Il y a à vrai dire là-bas une puanteur qui vous donne des haut-le-cur. Il y a une raffinerie de pétrole, une usine d'incinération d'animaux errants, une usine de nourriture pour chiens, et quand vous passez dans ce quartier, c'est comme se faire frapper à l'estomac tellement l'odeur est violente. Mais je l'adore. Et alors vous allez à quatre kilomètres et vous êtes dans les beaux quartiers de Denver. On se croirait à Disneyland : restaurants huppés, bars qui trient les clients sur le volet. Tout ça me met en colère, donc j'écris à ce propos.
k-libre : Au même moment dans Cry Father, on découvre la tragédie de Patterson. Son enfant Justin est mort. On le découvre petit à petit à la lecture de son témoignage. Est-ce que la mort de cet enfant est liée à ce quartier ?
Benjamin Whitmer : Je n'y avais pas pensé, mais je pense que tout est relié. Les personnes qui vivent dans ce genre de quartier pollué n'ont pas accès au système de santé. Il y a eu une nouvelle loi concernant notre système de santé, mais cela n'a pas d'impact sur les populations les plus démunies. Les gens meurent, et ils meurent de causes pour lesquelles ils ne le devraient pas. Mais c'est bon, personne ne s'en préoccupe, donc ce n'est rien.
k-libre : Un des thèmes principaux de votre livre pose la question de faire confiance ou non. Je pense entre autres à Patterson avec le docteur de son fils. Pour lui, faire confiance à un médecin est une évidence. Quand il se rend compte de sa propre erreur à travers l'erreur du médecin, il se sent trahi. C'est le nud de votre intrigue, non ?
Benjamin Whitmer : C'est ce que je disais à propos des théories du complot. Elles se développent avec le fait de ne pas savoir à qui l'on peut faire confiance. Vous êtes constamment dans une relation avec les autres, avec le gouvernement où vous n'avez aucune idée de ce qu'il se passe, si on vous ment ou non. Et je ne vois pas de solution. Aux États-Unis, il y a une tension constante entre le gouvernement et qui nous pensons être, et nous n'aimons pas ça. Je trouve ça très intéressant. Quand vous perdez un être cher - votre enfant -, que vous êtes désespéré, que vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, il n'y a rien à quoi se raccrocher. Alors, vous vous mettez à tout remettre en question. Vous entrez donc dans une forme de paranoïa, créée par notre pays.
k-libre : Comment mélangez-vous les situations horribles, et les situations drôles ?
Benjamin Whitmer : Je pense que je suis drôle, les autres ne le pensent pas. J'attends d'un livre qu'il me fasse rire aux moments inattendus. Habituellement, j'écris pour me faire rire. J'ai un boulot aux États-Unis, et je bosse avec un collègue qui, le pauvre, doit écouter toutes les blagues que j'écris. Je suis là : "Hey Josh, écoute ça !", et il éclate de rire. Quand il a lu Cry Father, il m'a dit : "En fait tu m'avais tout dis de ce livre !"
k-libre : Il y a beaucoup de situations absurdes dans ce livre.
Benjamin Whitmer : Oui, cela vient naturellement.
k-libre : Comment pouvez-vous décrire Patterson ?
Benjamin Whitmer : Encore une fois, je pensais beaucoup à mes enfants. En perdre un est la pire chose qui puisse m'arriver un jour. C'est bien la seule chose dont je ne me remettrais pas, et je leur dis souvent : " Je n'ai qu'une chose à faire, c'est vous garder en vie." Tous les jours que j'y arrive, je gagne. C'est une vie exceptionnelle. J'ai juste pensé comment cela me toucherait si ça m'arrivait. Tout ce qui lui arrive après ça m'a été inspiré par l'un de mes meilleurs amis, Lucas Bogan, un élagueur d'arbres. Il passe par Denver de temps en temps, et alors on disparaît pendant quelques jours. Il m'a raconté une fois sa vie, et son boulot, et j'étais là à penser : "Mec c'est une superbe histoire, je dois l'écrire." Patterson a le cur brisé, il est désespéré, il ne sait pas qui croire, et en qui avoir confiance. Je pense qu'il ne fait confiance à personne, mais qu'il ne veut pas lâcher prise. D'ailleurs, je pense qu'il ne peut pas. Aux États-Unis, on parle beaucoup de tourner la page, résoudre son souci et de lâcher prise. Personnellement, je pense que c'est des conneries. J'ai aimé créé un personnage qui n'allait pas le faire. Il ne fait confiance à personne, il est comme un scientifique ou un prêtre.
k-libre : Il apparaît très calme à l'extérieur...
Benjamin Whitmer : En vieillissant vous devenez meilleur pour traverser les méandres du quotidien. Peu importe ce que vous ressentez, vous devez vous lever, faire des choses. C'est irréfutable, c'est ça l'âge adulte : prétendre. On accepte mieux les rejets comme le chante Todd Snider avec "Too Soon To Tell Lyrics".
k-libre : Patterson semble aimer la nature. Il a une petite maison à la campagne sur une colline, et son plus grand plaisir est d'aller aux toilettes, à l'extérieur, la porte ouverte. Pourquoi ça ?
Benjamin Whitmer : Quand j'étais enfant, on n'avait pas l'eau courante, ni l'électricité, et c'était mon plaisir à moi. Mais en hiver je peux vous dire que ce n'était pas le cas, il faisait très froid, je détestais ça. L'endroit où il vit existe vraiment, dans la San Luis Valley. j'y suis allé pour camper quand j'écrivais mon livre, et dès que mes enfants seront grands, je partirai m'installer là-bas. Je vais acquérir ce chalet, et m'y installer. C'est mon but.
k-libre : Vous écrivez des romans uniques, pas de séries, donc vous devez recréer des personnages, encore et encore. Avez-vous un plan pour un troisième livre?
Benjamin Whitmer : Oui, je suis à cinq cents mots d'avoir fini le premier jet de mon prochain livre. Bon, ça veut dire que je dois encore travailler dessus soixante-dix ou quatre-vingts fois, parce que je suis un auteur très lent. Ce sera à propos d'une évasion aux États-Unis, qui se déroule en l'espace de quarante-huit heures. C'est une poursuite et, évidemment, les prisonniers sont les gentils de l'histoire.
k-libre : On dirait que vous aimez les livres qui ont du rythme. Cry Father c'est trois cents pages combinées en soixante-six chapitres. Là c'est un livre qui se passe en quarante-huit heures. Est-ce vraiment important pour vous ?
Benjamin Whitmer : Je suis un auteur bête, donc j'ai besoin de me mettre des limites que je sais que je ne vais pas dépasser, et ainsi écrire quelque chose de pas trop mauvais. Je ne m'imagine pas écrire un livre de six cents pages. C'est pareil pour une série car je m'ennuierai. Je fais un livre, et je passe à un autre, c'est comme ça que je fonctionne, et comment j'aime faire.
k-libre : Vous parlez de votre grand âge, mais vous n'en êtes qu'à votre deuxième livre !
Benjamin Whitmer : Je sais, j'ai traîné pendant vingt ans avant d'écrire Pike. C'était terrible ! Ça me prend beaucoup de temps d'apprendre à faire quelque chose correctement. J'adore écrire, je n'arrêterais jamais, je vais continuer, en espérant que ça soit bon !
k-libre : Vous écrivez des nouvelles?
Benjamin Whitmer : J'ai essayé, mais je suis terriblement mauvais. La dernière que j'ai écrite, m'a été demandée et payée deux cents dollars, mais j'ai mis six mois à l'écrire, et il s'est avéré que je n'avais écrit que dix mille mots. C'était atroce, donc plus jamais !
k-libre : Êtes-vous intéressé par l'Histoire de votre pays ?
Benjamin Whitmer : Oui, beaucoup. J'ai appris l'histoire des guerres indiennes pendant cinq ans. C'est ce que j'aime faire, quand je débarque dans n'importe quelle ville. Je vais obligatoirement atterrir dans le petit musée local. Quand je ne lis pas de roman, c'est ce que je lis. Car, pour moi, l'histoire des États-Unis remonte loin et est liée à l'idée de confiance. Nous avons une histoire étendue. Celle d'un holocauste démenti. On a une histoire terrible dont on ne parle pas. On ment à ce propos. Mes enfants quand ils rentrent de l'école me racontent les mensonges qu'ils apprennent tous les jours, et je leur dis : "Ah non, non, non, ça ne s'est pas déroulé ainsi, je vais vous raconter..." Pour moi, c'est infiniment intéressant de voir comment on essaye d'éviter l'histoire de notre pays, et que l'on continue de faire la même merde encore, et encore. En ce moment nous sommes dans une guerre perpétuelle. Je lisais un article génial là-dessus dans une revue de politique étrangère qui disait que nous ne connaîtrons jamais de notre vivant une période sans guerre dans notre pays. Et je me suis rendu compte qu'il en sera toujours ainsi. Qu'il n'y a pas eu une seule année de toute l'histoire américaine où notre pays n'avait pas de troupes terrestres quelque part. On oublie toutes ces guerres. On a oublié les Philippines. On les a toutes oubliées, mais les échos nous reviennent encore et toujours... Ça ne s'arrête jamais. On a toujours des troupes quelque part et, selon moi, nous sommes le pays le plus violent du monde. C'est ce que nous faisons. D'autres pays exportent du vin ou d'autres choses, nous nous exportons des forces militaires. C'est notre contribution principale dans ce monde. C'est intéressant selon moi. Nous sommes plus en désaccord à propos de la violence qu'à propos de sexe. Nous n'avons aucun moyen d'en parler, alors on fait des films idiots sur la violence pour essayer d'en parler, mais nous n'en parlons pas, on essaye de l'éviter.
k-libre : Il y a beaucoup de sexe, de violence et de drogues dans votre dernier roman.
Benjamin Whitmer : C'est extrêmement courant aux États-Unis. Je ne connais personne qui ne prend pas de drogues. Soit des drogues prescrites par le docteur, soit à côté, mais les drogues sont omniprésentes aux États-Unis. Je ne suis pas contre, mais pour moi ça indique un conflit que nous n'arrivons pas à gérer, alors on l'évite en se mettant la tête à l'envers - que ce soit avec du prozac ou de la cocaïne.
k-libre : Êtes-vous intéressé par l'écriture de western comme Elmore Leonard ?
Benjamin Whitmer : Ah oui oui ! Je suis un grand fan des westerns. Je suis extrêmement partagé encore une fois, parce que je trouve que beaucoup de westerns esquivent notre histoire. On raconte des histoires pour éviter les horreurs que nous avons commises. À la fin du XIWe siècle, il restait moins de deux cent mille indiens en Amérique, et ça alors que la population indienne était estimée entre vingt-cinq et cinquante millions d'individus avant d'être éradiquée. On esquive ces massacres tout le temps. On vit toujours en parallèle de notre histoire. On a toujours des réserves. On a toujours des populations qui vivent dans une pauvreté absolument abjecte. L'espérance de vie dans une réserve indienne tourne autour de quarante-trois ans, c'est à peu près mon âge.
k-libre : Est-ce le même problème aux États-Unis et au Canada ?
Benjamin Whitmer : Ils sont meilleurs car ils ont reconnu leur histoire mieux que les Américains. Ils ne sont pas géniaux, il y a aussi de très importants problèmes, mais ils ont commencé à trouver un accord avec les pensionnats indiens. Ici, on n'en parle absolument pas. Ce sont des taudis où l'on entasse les enfants, et où l'on passe des aiguilles dans la langue des gamins s'ils ne parlent pas correctement. On vit dans un monde qui commet ce genre de choses. Alors, selon moi, le fait d'éviter notre histoire permet de créer beaucoup de choses atroces qui se produisent dans le monde.
k-libre : À part John Dos Passos, quelles sont vos références littéraires ?
Benjamin Whitmer : C'est une question difficile... Je lis beaucoup de romans. J'adore Marilynne Robinson. J'aime beaucoup Cormac McCarty, alors j'essaye de ne pas écrire comme lui. Je m'assoie et je me dis : "Ok, je dois changer cette phrase, ça ressemble trop à Cormac." J'adore également Edward Abbey et James Crumley. Et beaucoup d'autres !
k-libre : Laurent Chalumeau vient d'écrire en France sa biographie d'Elmore Leonard. Il rappelle qu'un écrivain a dit de lui qu'il était un ennemi de la littérature car ses romans donnaient l'impression qu'il était facile d'écrire, mais que dans la réalité non. Qu'en pensez-vous ?
Benjamin Whitmer : Bon dieu non, c'est très compliqué d'écrire ! Cela demande énormément de travail d'écrire quelque chose qui ne ressemble pas à de l'écriture. C'est toujours mon but. Si je peux écrire quelque chose qui ne ressemble pas à des écrits, j'adore. Si je vais trop loin dans l'autre sens, à commencer à sonner comme un de mes auteurs préférés, j'en reviens à mes limites. Mon livre préféré est Moby Dick. J'adore Melville, mais je ne peux pas écrire comme lui.
k-libre : La moitié des Américains déteste Melville, et l'autre moitié l'adore. Comment expliquez-vous cet étrange phénomène ?
Benjamin Whitmer : Oui, vous avez souvent cette dichotomie. Il y a le camp Herman Melville, William Faulkner, Cormac McCarty, et le camp Mark Twain, Henry Hemingway, Raymond Carver. Je suis du côté Melville.
k-libre : Vous citez Mark Twain, mais vous semblez oublier Fenimore Cooper...
Benjamin Whitmer : Je déteste Fenimore Cooper, d'une haine absolument éternelle. Le Dernier des Mohicans est l'un des livres que je devais enseigner dans mon cours sur la représentation des indiens d'Amérique à travers la littérature américaine. On commençait avec les récits de captivité, j'ai donc dû relire Le Dernier des Mohicans pour la première fois depuis mon enfance, et j'ai failli le jeter par une fenêtre. C'était le pire des livres sur les Indiens avec un paquet de conneries. Je mourrais littéralement de l'intérieur. Je sais que certaines personnes l'adore, mais pffffiiiuuuu !
k-libre : Pourtant, l'un de ses ouvrages, La Prairie est fondateur de l'école naturaliste américaine d'où découlera le régionalisme symbolisé par Mark Twain et Willa Cather...
Benjamin Whitmer : C'est un livre intéressant, il parle des mêmes indiens, lesSioux, dont je parle dans Pike, la tribu des hommes banns. Ils ont été la première cible l'eugénisme au monde. On les a anéanti, puis on les retrouve à Cincinnati. C'est une histoire intéressante.
k-libre : Avez-vous lu beaucoup de westerns ? On les traduit en France notamment chez votre éditeur et sous la direction de Bertrand Tavernier dans la collection "L'Ouest, le vrai" chez Actes Sud...
Benjamin Whitmer : Vraiment ? Super ! J'en ai lu beaucoup étant enfant. Je voulais même être cowboy, puis j'ai changé d'avis. Ça demande beaucoup de boulot.
k-libre : Vous vouliez être John Wayne ?
Benjamin Whitmer : Je l'aime et je le déteste à la fois. Aux États-Unis, tout ce que j'aime je le déteste, et tout ce que je déteste je l'aime. C'est comme ça que l'on vit. Par exemple, La Prisonnière du désert est probablement dans le top 3 des meilleurs westerns réalisés par John Ford avec John Wayne, et c'est probablement le pire film raciste de l'histoire du cinéma. C'est un film pro-génocide : "Il faut exterminer les Indiens parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est violer des femmes blanches !" C'est un terrible film, mais je l'adore. J'ai dû le voir au moins deux cents fois. Même chose avec Sam Peckinpah, je comprends à quel point ses films sont sexistes et misogynes, mais j'en adore chaque minutes.
k-libre : Sam Peckinpah est bien plus violent que John Ford, non ?
Benjamin Whitmer : Je ne sais pas si je dirais ça. Les films de Sam Peckinpak sont délibérément violents, mais ceux de John Ford - courir partout pour tuer des Peaux-Rouges uniquement parce qu'ils ont la peau rouge, donc parce qu'ils sont indiens -, sont d'une violence différente. John Ford est plus romantique, même si Sam Peckinpah l'est à sa façon.
k-libre : Cela dit, vous êtes bien plus proche de Sam Peckinpak que de John Ford avec vos livres !
Benjamin Whitmer : Quand j'écrivais Cry Father, je me faisais la blague que j'écrivais le pire scénario pour un film de Sam Peckinpah. "Oh mon dieu ! Quelqu'un va se rendre compte que j'écris juste du Peckinpah..." Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre était que j'ai regardé Pat Garrett et Billy le Kid au moins quatre mille fois, et je voulais écrire un western moderne, avec deux personnages, Butch Cassidy et le Kid, et montrer ces hors-la-loi dans un contexte moderne.
k-libre : Êtes-vous intéressé par l'écriture pour le cinéma ou la TV?
Benjamin Whitmer : Non ! À vrai dire, j'ai refusé un deal. Je connais tant de grands auteurs qui sont partis à la recherche de l'argent que peut apporter le cinéma (parce que ça paye bien) et qui n'ont plus le temps d'écrire leurs livres. Je fais ce que je fais avec un boulot à côté, comme je le veux, afin de pouvoir écrire les livres que je veux, comme je le veux, et s'ils ne se vendent pas, je peux quand même survivre.
k-libre : Mais maintenant vous voyagez. Aurez-vous toujours autant de temps pour écrire ?
Benjamin Whitmer : Oui, j'ai le temps. Je protège très bien deux choses mon temps avec mes enfants et mon temps pour écrire. Ces deux choses ne s'effaceront jamais !
Propos aimablement traduits par Julie Prune Védrenne.
Liens : Benjamin Whitmer | Pike | Cry Father Propos recueillis par Julien Védrenne