

Boris Beuzelin est un dessinateur confirmé de bandes dessinées. Depuis plus de vingt ans, il publie régulièrement des histoires sombres. Il met son talent au service de scénaristes qui ont plus ou moins la même vision du monde que lui. Avec Black Gospel, il signe sa première collaboration avec Laurent Frédéric Bollée (scénariste du remarqué La Bombe, chez Glénat en 2020). Black Gospel, c’est une histoire à la Dahlia Noir. Une histoire de flics tourmentés par une enquête qui prend ses racines en 1963 à Washington et qui en 2013, cinquante ans plus tard, laisse encore traîner des séquelles. Une histoire à l’américaine dans un très beau noir et blanc. Petit retour sur la carrière de Boris Beuzelin, la rencontre avec Laurent Frédéric Bollée, et la genèse de cette histoire et certaines de ses aspérités.
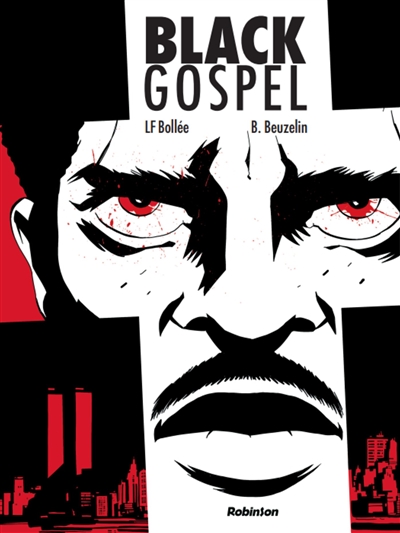
k-libre : Qu’est-ce qui te fascine autant dans les fictions noires, criminelles et policières ?
Boris Beuzelin : Ça vient de très loin et notamment de la vision du film L’Assassin habite au 21 de Henri-Georges Clouzot, une adaptation du roman éponyme de Stanislas-André Steeman. J’ai vu ce film très jeune, un soir ou il passait à la télé et le suspense était tellement angoissant que je suis allé me couché avant la fin du film que j’ai vue adulte, des années après. J’en ai fait des cauchemars, mais le poisson était ferré et cette attirance pour les récits noirs ne m’a plus quitté. C’est amusant de voir maintenant que ce film est quand même bien moins angoissant que Les Diaboliques ou Le Corbeau, mais dans la tête d’un enfant ça a fait son effet. Merci monsieur Clouzot, même s’il m’a fait découvrir la noirceur de l’âme humaine, mais il faut bien que quelqu’un si colle !
k-libre : Je t’avais découvert en 2006 avec l’adaptation du roman La Nuit des chats bottés, de Frédéric H.Fajardie, puis avec Carton blême, d’après l’œuvre de Pierre Siniac. Avec dans les deux cas une approche sociale forte. Pourquoi c’est important pour toi ?
Boris Beuzelin : Fajardie, je l’ai découvert à vingt-cinq ans et ça a été un autre choc. Jusque-là, j’étais plutôt attiré par des récits à énigmes en matière de polar, mais Fajardie m’a fait basculer dans le roman noir avec ses histoires à fort ancrage social. Il y a chez lui, une violence qui n’épargne aucun de ces personnages. Des récits souvent revanchards, des hommes et des femmes en lutte contre une société qui les broie. « Lorsque tout est pourri, on a raison de se révolter », fait-il dire à un des héros de La Nuit des chats bottés. Pas besoin de faire un dessin, ou plutôt si puisque j’ai adapté ce roman précisément. Et puis face à cette violence, l’amour occupe une grande place chez lui. Fajardie, ça a été un peu, pour moi, synonyme de passage à l’âge adulte. On avait pour projet de s’attaquer à son personnage fétiche, le commissaire Padovani, et j’avais commencé à travailler sur l’adaptation de Tueurs de Flics, mais malheureusement son décès prématuré a mis fin à ce projet.
Siniac, c’est un peu différent, plus éclectique dans sa bibliographie. Au départ, je devais adapter un roman de Tony Hillerman, mais ça n’a pas pu aboutir pour des questions de droits et finalement j’ai jeté mon dévolu sur Carton Blême, un roman court que je ne connaissais pas de lui, mais qui m’a tout de suite séduit parce qu’une fois de plus, le thème de la société qui abîme l’humain est central et son coté anticipation me permettait de proposer des images fortes d’un univers futuriste pas si éloigné du nôtre maintenant.
k-libre : Il y a un an, Carton blême a été réédité, transformé, chez Komics initiative. On avait parlé du scénario qui ne te plaisait pas à 100 %. Tu peux nous expliquer en quoi cette nouvelle version est différente ?
Boris Beuzelin : Ce n’est pas tout à fait ça, l’album est sorti en couleur chez Casterman, alors que nous devions le faire en noir et blanc. Je ne reviendrais pas sur le pourquoi de la chose, mais toujours est-il que la version couleur, bien que satisfaisante au final, n’a jamais vraiment eu totalement grâce à mes yeux puisque mes planches étaient réalisées en noir, au lavis et donc conçues pour être imprimées comme telles. Par ailleurs, le scénario de Jean-Hugues Oppel était très bien, d’autant que ce roman très court s’était révélé très compliqué à adapter et que je m’y étais moi-même cassé les dents. Pour autant, l’éditeur avait amputé le récit d’une dizaine de pages déjà dessinées et donc précédemment validées sur story board. La disparition, in fine, d’une séquence entière, à la manière d’un producteur de ciné qui charcute le film de son réalisateur. Ça faisait donc beaucoup pour un seul album. Comme nous avions récupéré les droits, la possibilité de ressortir l’album chez Komics initiative s’est faite jour et nous avons foncé. C’est donc une sorte de director’s cut, la version d’origine, en noir et blanc et avec les pages manquantes qui est maintenant proposée. Et, avec Jean-Hugues, on en est bien content !
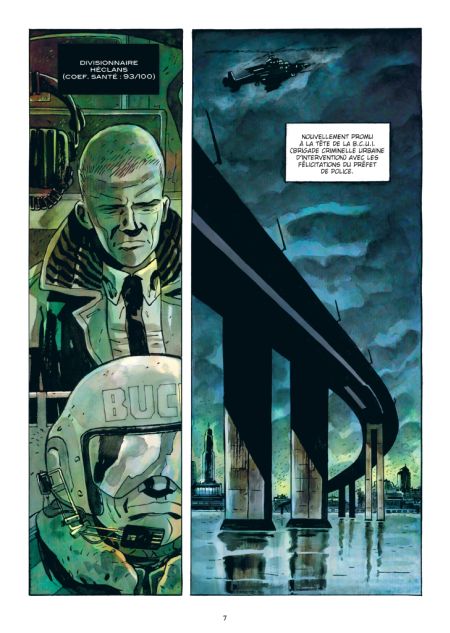
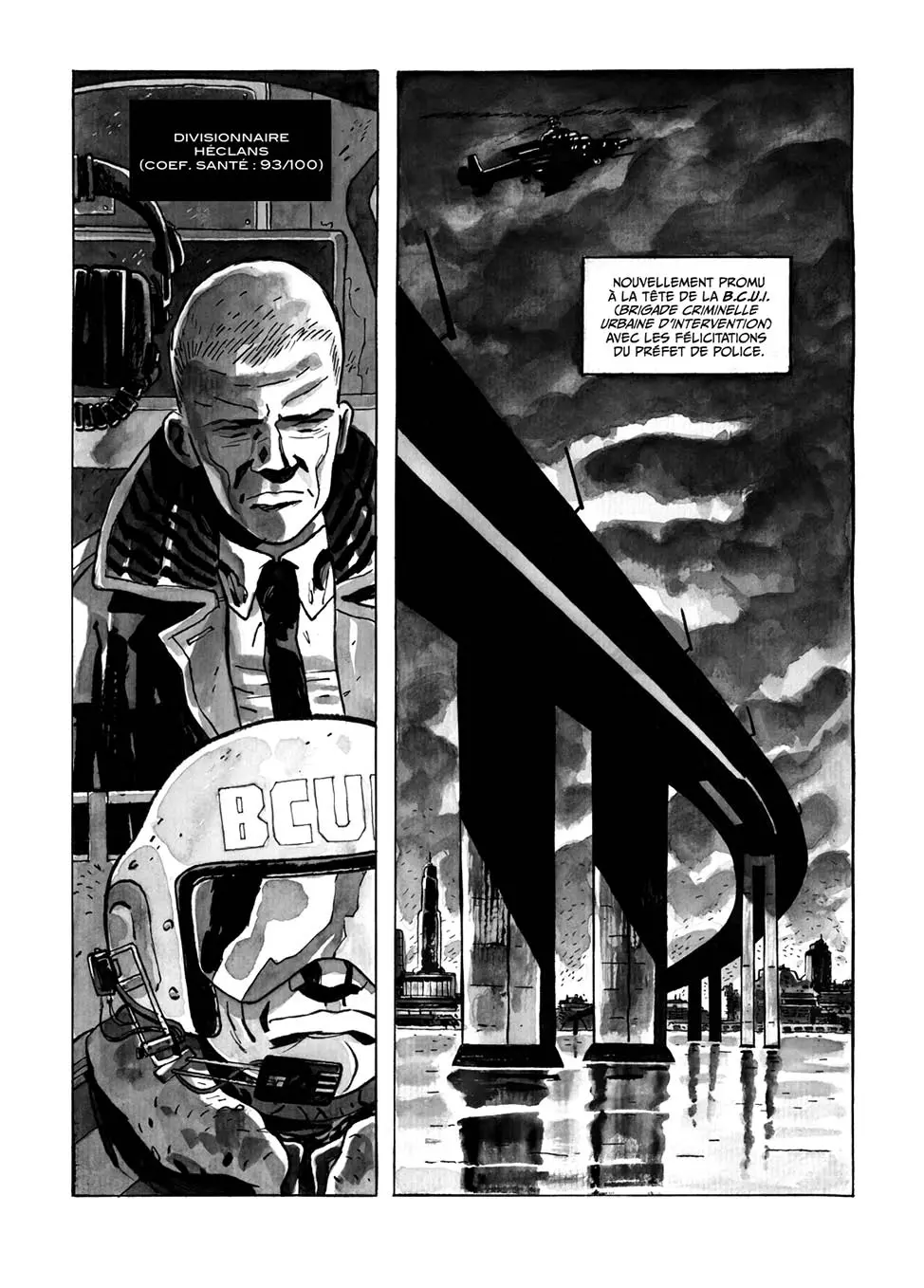
k-libre : Chez Komics initiative, il me semble que tu plonges plus dans un univers entre le pulp et le feuilleton populaire. Qu’est-ce que ça t’inspire et comment qualifies-tu ta collaboration avec le scénariste Tony Emeriau avec qui tu as réalisé Parias et La Cagoule & le pisse-copie ?
Boris Beuzelin : J’ai toujours été amateur des récits populaires du 19e et du début du 20e siècle. L’occasion s’est présentée avec Tony, suite à la sortie de ma série sur les Sanson, sur laquelle j’avais passé six ans sans interruption et qui m’avait épuisée. J’avais envie de quelque chose de fun, qui relèverait plus de l’imaginaire, et Tony m’a proposé de ressortir une histoire de S.-F. qu’il avait écrite une quinzaine d’années auparavant et que nous avons transposée dans un univers Steampunk, en référence, donc, à ces feuilletons que nous aimons tout les deux. Ce qui a vraiment façonné ce projet et qui lui a finalement donné son identité forte, c’est de l’avoir signé chez Komics Initiative. Ce que nous a proposé l’éditeur, Michaël Géraume, nous a immédiatement séduit car on a vite compris que nous aurions une grande liberté de manœuvre et de création sur le projet, plus que chez un gros éditeur. Ainsi Tony est au scénario et moi au dessin, mais cela reste une conception commune qui relève presque du « work in progress » permanent. À chaque début d’album, nous ne savons pas précisément combien de pages il fera. Nous invitons d’autres dessinateurs à venir « jouer » avec nous et nous construisons chaque album un peu à la manière d’un feuilletoniste qui part à l’aventure.
La structure de base a été posée par Tony, mais les péripéties varient au grès de l’avancée de l’album. Une fois celui-ci terminé, on met tout à plat et on réajuste, on transforme s’il le faut. C’est vraiment une grande satisfaction de pouvoir aller si loin dans l’élaboration d’un album, jusque dans la maquette et la fabrication.
k-libre : Auparavant, tu avais dessiné, au côté de Patrick Mallet, un triptyque teinté de fantastique sur les Sanson, une fresque générationnelle historique sur une famille de bourreaux. L’histoire avec un grand « H » et une grande « hache » qu’est-ce que ça t’offre en termes de dessin et de liberté ?
Boris Beuzelin : C’était, pour moi, la première fois que j’abordais un sujet historique avec autant de travail de recherche, notamment iconographique. L’histoire court sur presque deux cents ans, sous l’Ancien Régime, avec la Révolution française en point d’orgue. Donc au début, la liberté je ne l’ai pas vraiment trouvée, j’étais plutôt prisonnier de toute cette documentation qu’il fallait digérer. Quand on aborde un sujet historique, on craint toujours de faire des erreurs. Puis peu à peu, une fois bien rentré dans l’histoire, cette pression c’est estompée et mon dessin c’est libéré lui aussi pour ne plus ce concentrer sur le détail, mais sur la narration et la force iconographique des images qui est au cœur de mon approche de la BD.
k-libre : Black Gospel est ta première collaboration avec Laurent Frédéric Bollée (La Bombe, Le Maître de California Hill). Comment s’est amorcée cette rencontre ?
Boris Beuzelin : Il y a une dizaine d’années, nous avions un projet de polar, en noir et blanc lui aussi, qui était sur le point de se signer, ce qui finalement n’a pas été le cas. C’est l’éditeur qui nous avait mis en relation, connaissant, sans doute, mon appétence pour le polar et les récits noirs. Nous sommes donc repartis chacun de notre côté, puis Laurent-Frédéric m’a recontacté il y a deux ans. Il avait écrit un autre polar, Black Gospel donc, et il me proposait de le dessiner. J’ai lu son histoire qui m’a beaucoup plue et j’ai bien sûr accepté dans la foulée. Et cette fois ça a abouti.
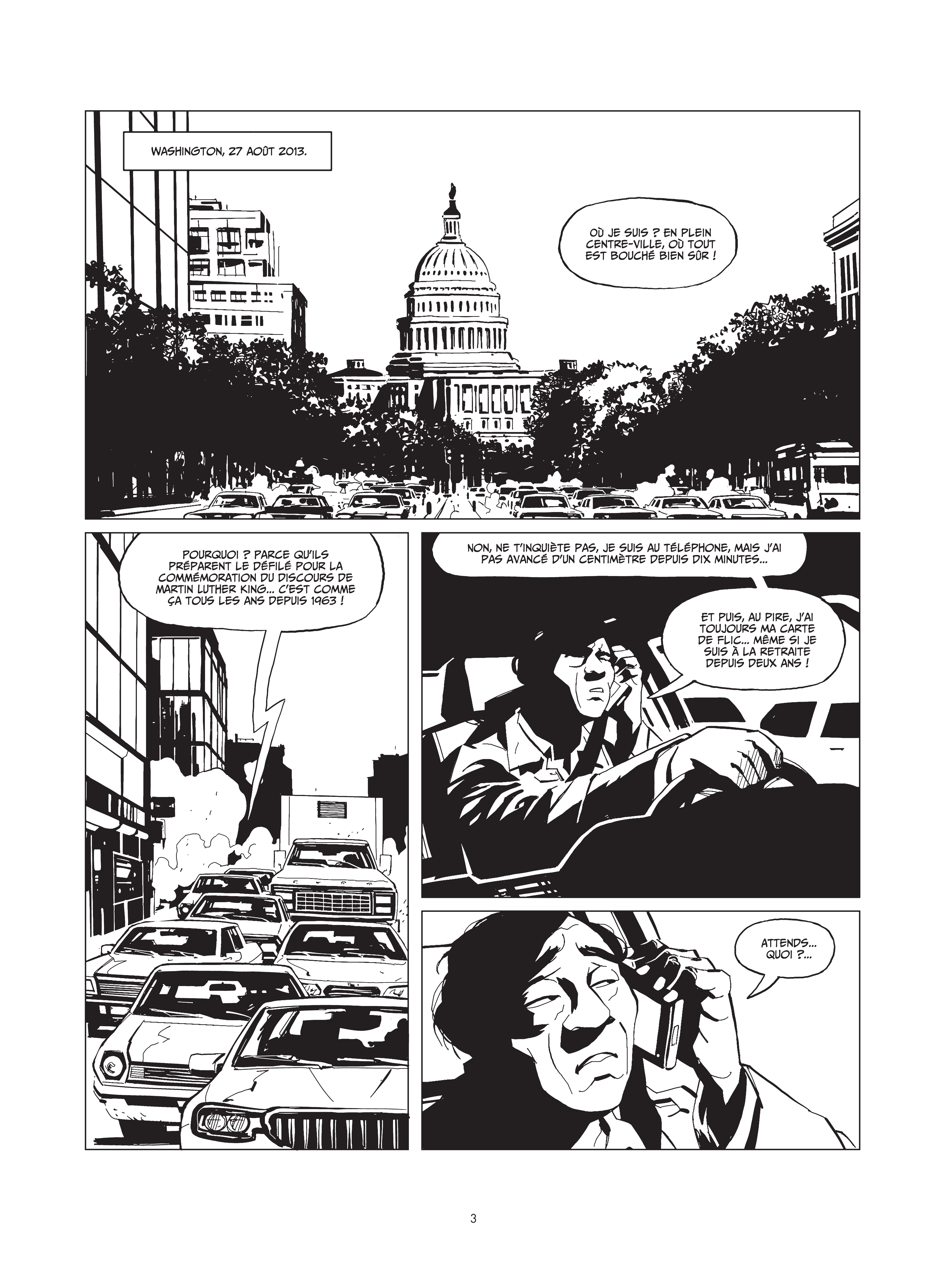
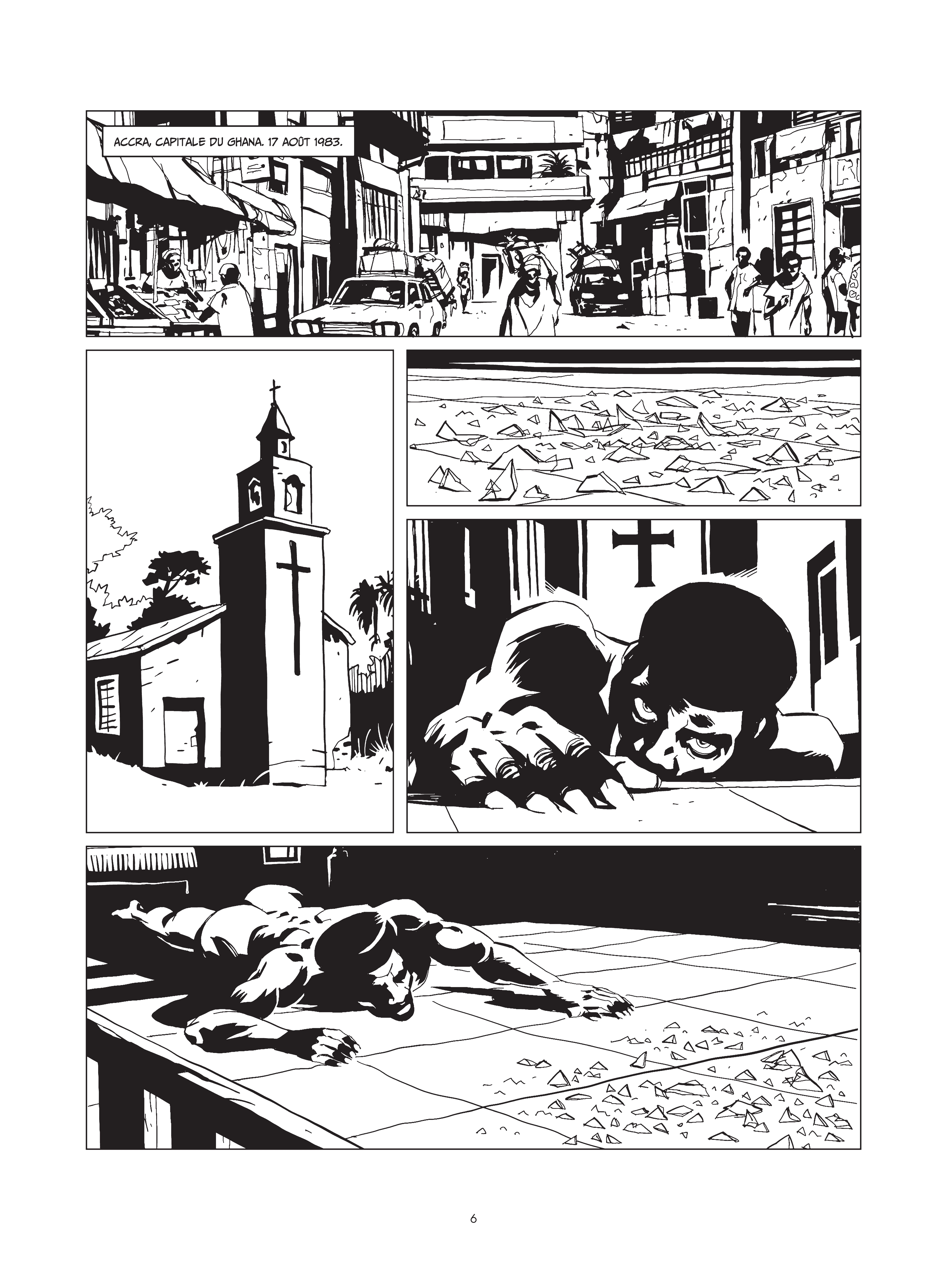
k-libre : Black Gospel, c’est une histoire de flics à l’américaine, très visuelle, très ancrée dans un certain cinéma des années 1960-1980. Tu as fait le choix d’un noir et blanc très stylisé sur papier glacé. En quoi ce choix s’est-il imposé ?
Boris Beuzelin : Le choix du papier n’est pas de mon fait, mais celui du noir et blanc s’est imposé naturellement et c’est Laurent-Frédéric qui me l’a proposé. Je pense que c’est comme ça qu’il le voyait quand il a écrit son histoire. Et ce choix radical au service d’une histoire si noire permet de donner une force particulière aux images qui vont au-delà du simple fait de ce qui est raconté. Étant très amateur du courant expressionniste, tant pour le cinéma que pour la peinture, je dois dire que je n’ai pas ménagé mes effets dans ce sens. Le dessin de bande dessinée n’est pas la simple illustration du scénario, il doit raconter plus et proposer au lecteur une expérience émotive qui ne serait pas pleine et entière s’il n’existait que le texte et inversement s’il n’y avait que l’image. La BD c’est une combinaison, une rencontre entre ces deux disciplines que sont l’écriture et le dessin.
k-libre : L’histoire est éclatée à travers trois époques (1963, 1983 et 2013). Qu’est-ce que ça amène en termes de rythme et quels défis cela procure au dessinateur ?
Boris Beuzelin : C’est écrit à l’américaine, donc ce qui est bien c’est que le dessinateur peut se promener dans des séquences qui sont comme des petites histoires en elles-mêmes et passer d’une ambiance à l’autre, les États-Unis et le Ghana dans le cas de Black Gospel, sans que cela soit vraiment contraignant car les décors changent en permanence. C’est très riche et donc très passionnant à dessiner, comme un petit univers à construire sur chaque nouvelle séquence. Ce qui reste immuable ce sont les personnages, enfin ceux qui restent en vie, mais ils évoluent eux aussi dans leurs comportements et les rapports qu’il ont entre eux. C’est là aussi une valeur ajoutée que le dessinateur peut apporter dans la façon d’aborder l’évolution des postures des personnages, s’habillent se regardent. Ce ne sont pas des choses qui doivent sauter aux yeux du lecteur, mais c’est là et ça renforce la crédibilité du récit.
k-libre : Jack Kovalski est un bon flic de New York. Un flic qui a des intuitions. Il va quitter la Grosse Pomme pour Washington. Et là, ce flic raciste va se retrouver sous les ordres de Mike Gardner, un commissaire noir, et à avoir comme équipier Jimmy Cheng, un flic assez caustique qui ne s’en laisse pas trop raconter. Le tout à quelques jours de la commémoration du discours de Martin Luther King. C’est un chamboulement idéologique pour Kovalski ?
Laurent-Frédéric Bollée : À la base, c’est juste la suite d’une enquête « normale » – il s’occupe de meurtres à New York, mais il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que l’épicentre du futur tremblement de terre à venir se déroule à Washington. Donc, il y va. Mais nous l’avons fait assez arrogant, persuadé qu’il va montrer aux flics de la capitale (globalement des « planqués », qui n’ont rien à faire dans une ville aussi « tranquille ») ce que c’est qu’un vrai inspecteur confronté chaque jour à des « vraies » affaires ! Mais bien sûr, il n’avait pas soupçonné que l’adversaire en face de lui était aussi déterminé…
k-libre : On ne peut pas aborder Black Gospel sans parler de Bella Jackson, personnage trouble et captivant, à l’origine de toute cette histoire. Qui est-elle ?
Laurent-Frédéric Bollée : Une avocate afro-américaine brillante, qui a fait des études supérieures et qui est ambitieuse en plus d’être très belle. Elle est fiancée au chef de la police de Washington, ils symbolisent une intégration réussie de la communauté noire. Mais elle a fait un voyage « initiatique » en Afrique de l’Ouest durant sa jeunesse et sans le savoir elle a déclenché un tsunami émotionnel qui va la poursuivre bien malgré elle jusqu’en 1983…
k-libre : L’intrigue de Black Gospel n’a pas une mais plusieurs origines. Parmi l’une d’elle, la concomitance entre le discours de Martin Luther King à Washington et la mort de W.E.B. Du Bois au Ghana, sans oublier un attentat du Ku Klux Klan dans une église quelques jours après « I have a dream ». En quoi ces trois faits vont-ils percuter votre intrigue ?
Laurent-Frédéric Bollée : Tout est lié. Le discours est un événement en soi, devenu depuis « légendaire » – et il est vrai que MLK a été un orateur génial ce jour-là, que les mots sont forts et puissants, et que la cause est toujours aussi importante et d’actualité. D’un point de vue historique, la mort de Du Bois la veille du 28 août est en effet passée largement au second plan, et il nous a semblé intéressant d’y voir un ressort dramatique « original » pour un thriller. Enfin, l’attentat dans l’église de Washington, horrible, rappelle que la fiction ne remplace globalement jamais la vérité, comme si les mots de King n’avaient servi à rien… D’où une tension générale intense pour notre récit.
k-libre : Black Gospel, c’est aussi une histoire d’amours contrariées qui tournent autour du père Sagosia à Accra. Lui c’est quelqu’un qui a vécu dans l’ombre d’une icône, qui a été libraire et qui a fini par entrer dans les ordres. Comment expliquer sa personnalité ?
Laurent-Frédéric Bollée : C’est un enfant qui vit avec son père, majordome du Du Bois, en contact donc du grand écrivain. Comme ce dernier est l’hôte officiel du Ghana et qu’il jouit d’un certain prestige, on peut concevoir qu’Isaac (c’est son prénom) est fasciné par le grand écrivain. À sa mort, il veut perpétuer sa mémoire, mais les événements politiques survenus au Ghana à la fin des années 1960 (authentiques) sont un premier frein puissant. Ensuite, au début des années 1970, sa rencontre avec Bella, et la déception amoureuse qui suit, est évidemment l’élément final qui le fait sombrer dans la folie. Le fait qu’il devienne ensuite prêtre ne nous semblait pas impossible car il est croyant – mais surtout il voit tout de suite que ce rôle, cette apparence, cette « façade » (assumée) servira ses desseins. En fait, dès le début, Isaac est un être qui se tient prêt à être sacrifié. Il ne cesse d’aller vers son bûcher…
k-libre : Enfin, les seules bonnes histoires de flics sont-elles celles qui les condamnent à rester tourmentés par cet aspect sisyphéen de leur métier qui fait qu’ils arrivent toujours trop tard ?
Laurent-Frédéric Bollée : Course contre la montre, suspense, intuitions contre réalités, c’est surtout une lutte face au temps et à son côté implacable. L’horloge tourne et ne revient jamais en arrière. Il faut aller de l’avant, quitte à se prendre des coups. Voire à mourir. Jack, lui aussi, traverse la vie en sachant qu’un jour il se fera sauter le caisson – car au moins, là, il aura l’impression d’avoir été maître de son destin…