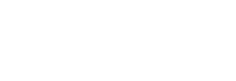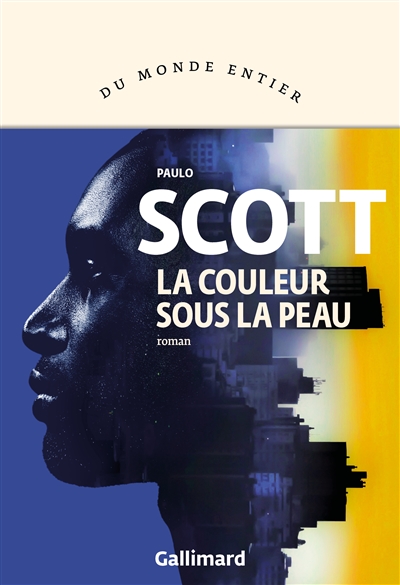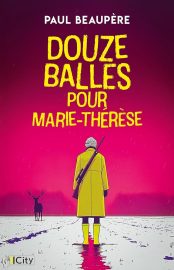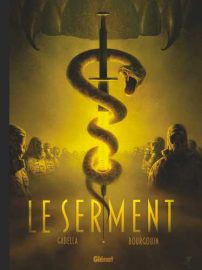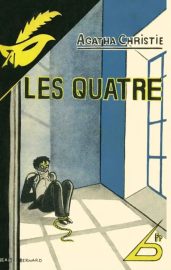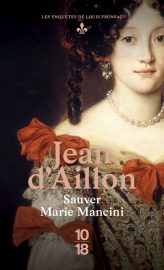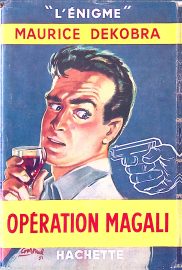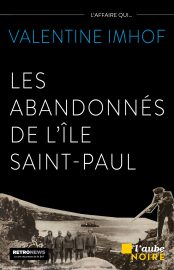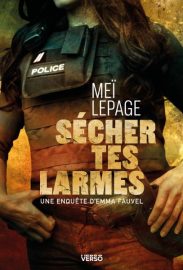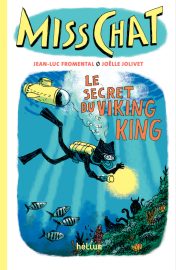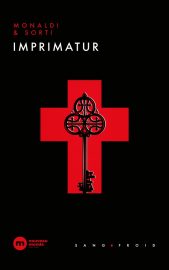Federico, le narrateur, est un jeune homme qui vient d’une famille métisse, mais alors que lui a la peau blanche, son frère, Lourençao, est noir. Adolescents, ils ont tenté de se faufiler dans une fête branchée. On les rejette, s’ensuit une bagarre entre eux et d’autres adolescents. Dans le feu de l’action, Lourençao sort un revolver et tire sur l’un des assaillants, le tuant. Les deux frères se sont sauvés et ont caché l’arme. Puis, Federico est entré en politique pour aider les gens de couleur et faire adopter des lois sur la diversité et des quotas pour les minorités. Depuis, il travaille pour un ministère et doit participer à une commission pour gérer de nouveaux droits (ou les supprimer) afin d’augmenter le nombre de Noirs dans la population étudiante. Mais alors qu’il essaie de faire progresser sa cause, il est contacté par son frère : en marge d’une manifestation, sa nièce a été arrêtée par la police et on a découvert sur elle une arme à feu (inutilisable car très vieille, mais c’est l’intention qui compte pour la police). Les deux frères comprennent que l’arme en question est celle qu’ils avaient cachée dans la maison des années plus tôt. Que peuvent-ils faire pour sauver la jeune fille ? Quand ils vont au commissariat de police et découvrent que le responsable de l’arrestation n’est autre qu’un membre de la famille de l’homme abattu par Lourençao, ils se rendent compte que la situation est plus complexe que prévue.
Roman paru dans la collection « Du monde entier », plus généraliste et orientée littérature « blanche » chez Gallimard, La Couleur sous la peau explore un thème qui, par-delà le Brésil, concerne de nombreux autres pays. Autant il peut être facile dans certains pays où la colonisation a laissé des traces durables de séparer les gens suivant des critères fallacieusement raciaux, autant cela peut s’avérer complexe au Brésil, par exemple, où les mélanges ont été nombreux, où à l’intérieur même des familles les caractères génétiques ont été marqués de manière subtilement différente. À travers le cas de cette famille, on voit aussi les répercussions que cela peut avoir : que faire pour défendre son frère quand il est plus « typé » que soi ? L’intrigue de Paulo Scott revient aussi, de manière détournée, sur la période de la dictature militaire, sur la corruption endémique, sur les subtilités de la démocratie et les façons de s’en servir. Le tout donne un roman noir intéressant loin des problématiques policières, mais ancré dans des thématiques sociales violentes, entre sociologie et histoire personnelle.