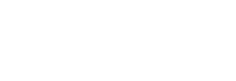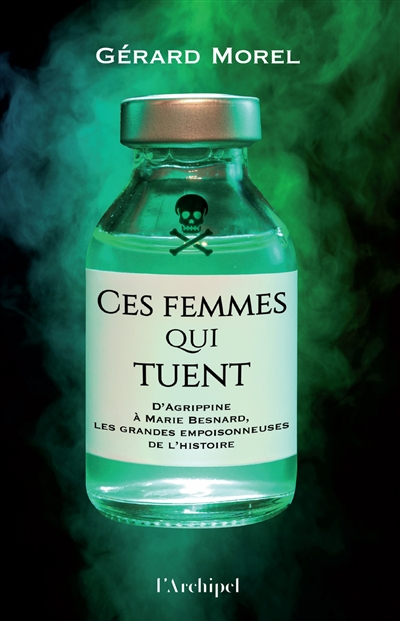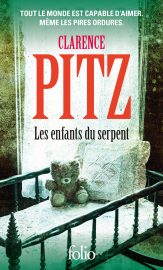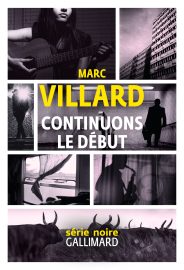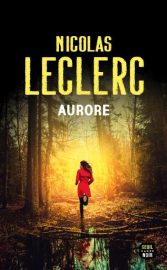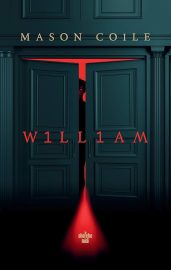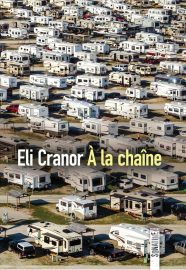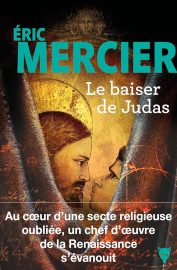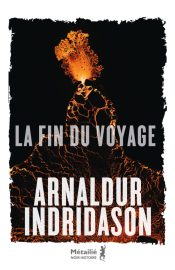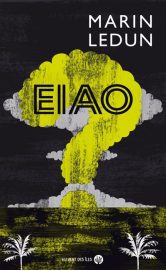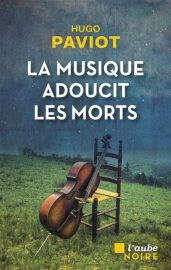Gérard Morel, magistrat de l’ordre judiciaire, propose à travers ce nouvel ouvrage sur des empoisonneuses treize portraits de femmes létales, voire fatales. En commençant par celui d’Agrippine, l’auteur veut internationaliser quelque peu son propos (même s’il ne va qu’à l’extérieur proche de nos frontières, en Italie, avec également Giulia Tofana, qui n’est pas sans avoir de points communs avec La Voisin), mais (par volonté ?) ne va pas puiser hors des sentiers battus. Surtout, il plante le décor : ces femmes sont quelque part des femmes de pouvoir et vont lutter avec leurs propres armes pour jouer dans la cour des hommes (à l’instar des femmes fatales du film noir). Et c’est bien le fil de la pensée de Gérard Morel qui s’en explique et dans un avant-propos et en conclusion. Quasiment toutes ces femmes ont déjà fait l’objet de nombre de publications avec force détails. Aussi, on ne peut attendre de révélation.
Seulement, Gérard Morel fait preuve d’un joli style décalé, entre l’ironie et la causticité, lorsqu’il brosse ces tableaux. Il relate les faits, contextualise, tente de s’immiscer dans la psyché de ces meurtrières. Mise à part cette façon qu’il a de redire ce que l’on peut être en mesure de déjà connaître, on pourra lui reprocher un manque de transversalité. Qu’est-ce qui relie ces femmes ? Pourquoi ses choix ? Qu’y a-t-il de commun ou pas entre la comtesse de Brinvilliers et Marie Besnard ? Surtout que l’auteur s’est fendu d’une préface qui laisse présager. Il nous raconte la place du poison dans le code pénal à travers les époques. Nous explique que le poison est affaire de femmes (non sans donner par la suite nombre de contre-exemples) et que dans une société tenue de main de maître par les hommes, il incombe de juger plus fortement les femmes. Surtout : le poison est synonyme de préméditation (il aurait pu ajouter à l’agonie plus ou moins longue).
Le propos est entendu mais, par la suite, il n’est que très peu étayé. Et c’est bien dommage car les portraits de ces femmes captivent par sa plume et par leur aspect hors du commun. Tout est affaire de luttes de pouvoir que ce soit au plus haut sommet de l’État que dans une chaumière du fin fond de la France profonde. Ces femmes meurtrières jouent pour la plupart des sentiments et du poison pour parvenir à leur fin, et quand elles finissent par être prises (le syndrome d’Icare), elles demeurent fières. C’est peut-être là aussi leur point commun. Elles ont joué avec des dés pipés. Ou alors, comme le sous-entend l’auteur, il ne s’agit que des femmes qui ont été prises la main dans le poison… D’autres ont peut-être été moins « gourmandes ». L’ouvrage de Gérard Morel se lit comme une suite de nouvelles policières historiques de bonnes tenues. On peut même y déceler quelques recettes. À bon entendeur !
Liste des « Femmes qui tuent » :
Agrippine
Catherine de Châteauneuf, veuve d’Haussonville
Giulia Tofana
Marie-Madeleine d’Aubray, marquise de Brinvilliers
Catherine Deshayes, veuve Montvoisin, dite « La Voisin »
Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, épouse d’Aulnoy
Hélène Jegado
Marie Capelle, veuve Lafarge
Adèle Landoy, dite « Sido »
Marie Thérèse Ablay, épouse Joniaux
Les Joyeuses empoisonneuses marseillaises
Violette Nozière
Marie Davaillaud, veuve Besnard